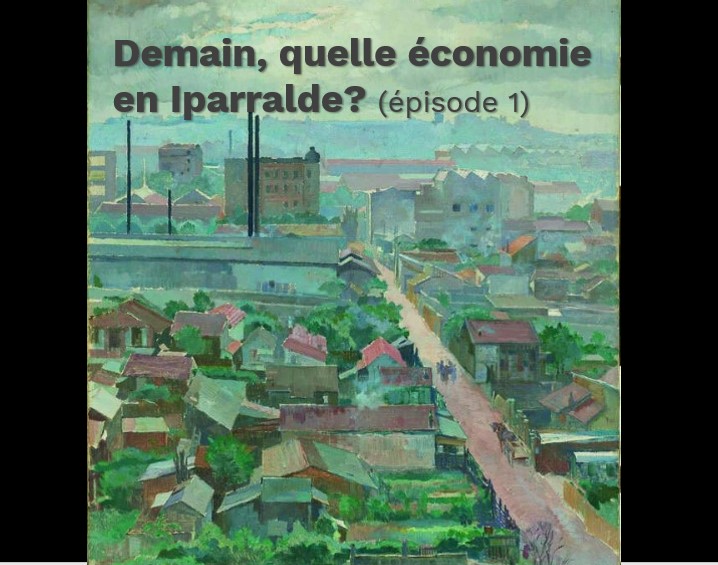[image d’un peintre inconnu: un paysage industriel de la fin du XIXième siècle]
NB sur IPARRALDE: je choisis à escient cette expression en basque qui définit le Pays Basque Nord, celui qui se situe côté français (ou « côté nord », en contrepoint de l’autre partie du Pays Basque, situé en Espagne, que l’on appelle ici « Hegoalde », côté sud, pour simplifier). Avec la notion d’Iparralde on sort d’une notion administrative, d’un périmètre qui a tant évolué avec l’histoire, pour parler du territoire dans toutes ses dimensions…
*CHRONIQUE PARUE DANS L’HEBDOMADAIRE MEDIABASK DU 6 NOVEMBRE 2025
Après avoir montré les ressorts de notre économie territoriale*, projection sur l’avenir économique du Pays Basque. Premier épisode : le cap.
Alors qu’elle constitue le levier majeur de la transition écologique et de la souveraineté locale, la question économique est quasiment absente du monde militant basque. Il est temps de repolitiser l’économie !
Il y a 20 ans, le projet économique était au cœur des travaux de Pays Basque 2020. Le débat éco était marqué par le discours (et même l’idéologie) de l’attractivité ; autrement dit une histoire de “ruissellement” avant l’heure. Laurent Davezies, expert en économie régionale, était invité partout dans l’Hexagone pour défendre une économie locale basée sur la captation de revenus : attirer de nouveaux habitants, “métropoliser” les territoires urbains… Nous étions un certain nombre à dire que, poussé à son paroxysme, le logiciel Davezies nous conduisait dans le mur et assécherait le territoire de ses savoir-faire. C’était renoncer au pari de la génération de nos parents, qui ont créé des entreprises dans les années 1960 et 1970, à la dynamique Hemen-Herrikoa et à de nombreuses autres. C’est ainsi que s’est dessiné un projet économique autour du renforcement de l’économie productive, du soutien aux filières, aux clusters, etc. La Communauté d’agglomération Pays Basque a hérité de ce projet et l’a poursuivi. Mais quel est le pas suivant, alors que ce projet ne fait plus l’objet d’un travail collectif ?
Dans une certaine discrétion, la Chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque (CCI) a motivé le syndicat du Schéma de cohérence territoriale (Scot) à collaborer avec le cabinet et think tank Utopies pour replacer la question de la résilience économique, donc écologique, dans l’aménagement futur du territoire. L’analyse du métabolisme économique sur le périmètre du Pays Basque et du Seignanx fait apparaître que 61% de la consommation locale dépend de l’importation de biens et services, et 61% de la production locale est exportée ; ce sont 20 milliards d’euros de “fuites économiques” sur un total de flux estimés à 34 milliards d’euros sur notre territoire (moitié consommation, moitié production). Si nous ne prenions que les produits manufacturés, les ratios dépasseraient très largement les 80% ; au niveau français, deux tiers de ces produits sont importés. Le Pays Basque dispose donc de très grandes marges de progression pour relocaliser la production et la consommation, et ainsi réduire son empreinte écologique.
Relocaliser passe par un réinvestissement dans notre appareil de production locale. Bref, se mettre d’accord sur cette perspective d’un territoire plus productif, plus industriel qu’il ne l’est aujourd’hui, plus diversifié dans sa production agricole. Cela passe bien entendu aussi par un pacte avec les consommateurs locaux : relocaliser l’acte d’achat des citoyens, réduire la consommation de produits venus de loin et/ou à fort impact carbone comme la viande.
Dans sa dernière production, L’Entreprise hyper-locale (Éditions Pearson), l’équipe d’Utopies démontre par a + b comment se réinventent, aux quatre coins de l’Hexagone et dans d’autres pays du monde, de nouveaux modèles économiques à partir du local : là où se créent une meilleure valorisation des ressources, des boucles circulaires (réutilisation des ressources en déchets), des coproduits entre activités (la laine devient un isolant, par exemple), de nouvelles coopérations entre acteurs économiques et sociaux… Bref, un modèle circulaire, avec des approvisionnements et des débouchés régionaux. Une orientation en phase avec la recherche, dans tous les pays européens, de plus de souveraineté économique (et notamment industrielle), alors que notre niveau de dépendance technologique envers les pays où nous avons délocalisé est inquiétant, l’accès aux ressources de plus en plus aléatoire et les conséquences du dérèglement climatique toujours plus imprévisibles…
Voilà donc un cap que nous pourrions mettre en débat et partager collectivement, pour que la question économique revienne au cœur de nos approches prospectives. Sur le comment, je suggère de creuser trois dimensions :
– Le récit économique et la valorisation de l’entrepreneuriat territorial.
– La réflexion sur les contenus économiques (que devons-nous produire et consommer ?).
– Le développement local et la gouvernance économique.
*Voir les deux chroniques à ce sujet: