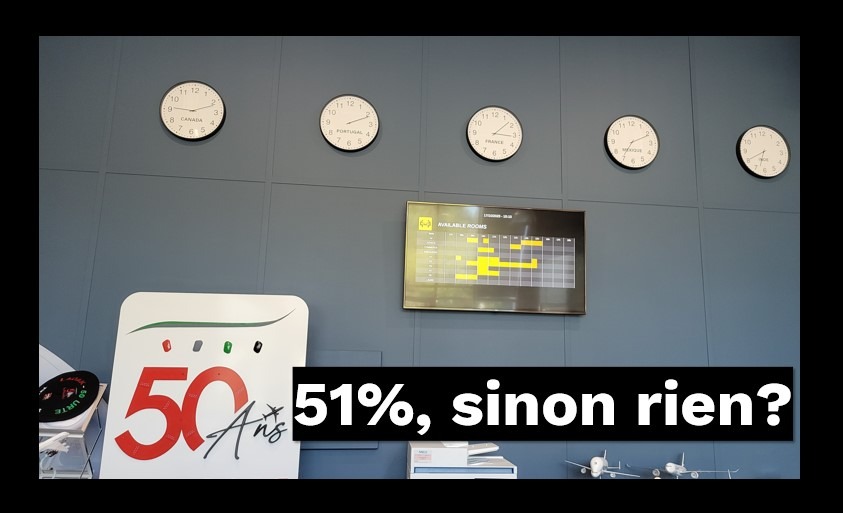Ci-dessus, photo prise dans le hall d’entrée de Lauak à Hasparren, lors de notre RDV avec Mikel Charriton (©bidean)
DOSSIER PARU DANS L’HEBDOMADAIRE MEDIABASK DU 23 OCTOBRE 2025
Créé en 1975 à Hasparren, le Groupe Lauak est emblématique à la fois de l’histoire de l’aéronautique, de ses mutations et des défis actuels. Comment une entreprise basque se retrouve dans les bras d’un géant indien ?
par Filipe Arretz (bidean) et Tidjan Peron (rédacteur en chef de Mediabask)
Dans quelques jours, quelques semaines tout au plus, la famille Charritton devrait avoir le feu vert de Bercy et céder 51 % du capital du Groupe Lauak au groupe indien Wipro. Le dossier est entre les mains de la direction générale de l’armement, au sein du ministère des Armées – la partie militaire représente entre 3 et 4 % du chiffre d’affaires de Lauak. Puis, il fera l’objet d’un arbitrage par le ministère de l’économie et des finances au titre du contrôle des investissements étrangers en France. Même si des garanties complémentaires pourraient être demandées, l’affaire semble quasiment conclue, selon le patron de Lauak. Wipro a exigé d’être majoritaire comme condition de son investissement, et pour Mikel Charritton, le choix d’un partenaire industriel était une question de pérennité. Lauak a connu une forte croissance ces dernières années. Il a racheté des entreprises pour peser 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec près de 2 000 emplois au total, répartis entre le Pays Basque (500), le Gers, le Portugal, le Mexique, le Canada et l’Inde. Toujours selon son dirigeant, Lauak vit une “crise de croissance”.
Le carnet de commandes est plein pour les cinq prochaines années, mais il pourrait se tarir sans anticiper les investissements nécessaires pour le prochain cycle du secteur aéronautique, autour de “l’avion du futur”. Pour Mikel Charritton, Lauak ne pourrait grandir et absorber seul ces investissements : “Soit on mange, soit on se fait manger. Autant choisir par qui on veut se faire manger”, résume-t-il. Selon le récit qu’il fait de cette vente, Wipro s’est révélé comme une opportunité pour Lauak, et Lauak, une opportunité pour Wipro, qui trouve là une “pépite” pour se diversifier dans l’aéronautique.
Pour l’économiste et chercheur à l’université de Bordeaux Vincent Frigant, il y a peu d’entreprises de la taille de Lauak qui se sont autant adaptées aux différents cycles du secteur et aux mutations du marché. C’est pour cette raison qu’il exprime sa surprise sur l’opération avec Wipro, qu’il estime “à contrecourant” des orientations françaises et européennes sur la souveraineté industrielle. Cela interroge, selon lui, non seulement les stratégies industrielles des pouvoirs publics mais aussi la conditionnalité des aides publiques. “Comment peut-on passer si vite d’Hasparren à l’Inde ?”, s’interroge-t-il. Pour lui, l’État français fait preuve de “négligence” vis-à-vis d’entreprises de taille intermédiaire, à mi-chemin entre les PME et les grandes entreprises, comme Lauak.
Comme le montre l’histoire de l’aéronautique, le secteur n’a cessé de connaître des cycles dans des contextes de plus en plus globalisés. Les grands donneurs d’ordre comme Airbus mettent la pression sur leurs sous-traitants, qui doivent beaucoup investir. Malgré ces grandes mutations, la dimension artisanale de ce secteur – où la main d’œuvre est essentielle, les savoir-faire directement liés aux salariés – en fait une “industrie peu mobile”, selon l’économiste. C’est ce à quoi semblent se raccrocher les différents responsables politiques et économiques interrogés.
“C’est une industrie peu délocalisable. Dans cette affaire, ce sont les Indiens qui ont intérêt à venir en Europe”, assure le président socialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. “C’est la preuve que notre industrie locale intéresse à l’international”, enchaîne le président de la Chambre de commerce et d’industrie Bayonne – Pays Basque, André Garreta. À l’international justement, les pays asiatiques sont hyperactifs, en témoignent les rachats récents à Lourdes (Hautes-Pyrénées) et Figeac (Lot) de PME par des Taïwanais et des Indiens. Vincent Frigant rappelle que l’Inde a un vrai plan de développement industriel, baptisé Make in India (fabriquer en Inde, en anglais) : “C’est stratégique pour eux d’acquérir des compétences. Ils ont beaucoup d’ingénieurs et investissent beaucoup, comme l’ont fait les Chinois”.
Était-il possible de faire autrement ?
Les dirigeants de Lauak n’ont, semble-t-il, pas ouvert d’autres pistes, mais plutôt saisi une offre qui se présentait à eux. Ce choix en a surpris plus d’un, à commencer par Alain Rousset : “J’aurais préféré que la Banque publique d’investissements [NDLR : dont le but est de soutenir financièrement les entreprises] rentre au capital de Lauak”. Ce dernier estime que le projet de vente de Lauak pose un “problème de souveraineté”. “La souveraineté industrielle passe par une politique de fonds propres qui renforcent les PME sur le temps long. Le modèle du système capital-risque français est un boulet.”
L’État français ne semble ainsi pas se donner les moyens de sa réindustrialisation, et le centralisme du financement de l’économie est peu efficace. C’est aussi le constat effectué par la commission d’enquête sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises, qui a remis son rapport en juillet dernier. Elle démontre l’absence d’évaluation des 211 milliards d’euros d’aides annuelles aux employeurs. Les deux sénateurs qui en ont piloté les travaux partagent la même analyse sur l’absence de conditionnalité claire de ces aides : “Il est légitime d’aider les entreprises, mais quid de la contrepartie qui devrait leur être demandée ?”, indique Olivier Rietmann (Les Républicains).
Quel est donc le rôle des collectivités territoriales ? Si la Région aide les PME, elle ne peut pas investir dans des entreprises de plus de 250 salariés. Les territoires sont dépendants du “centralisme politique, industriel et administratif”, selon Alain Rousset. Et de citer les Länder allemands avec une forte autonomie et des banques régionales d’investissement. L’Agglo Pays Basque, quant à elle, est principalement compétente sur le foncier économique. Sur l’aéronautique, son action porte sur “le renforcement de l’écosystème local”, et notamment les outils d’appui à l’innovation, indique Sylvie Durruty. Même attitude côté CCI, où André Garreta valorise la politique de centres technologiques dont la chambre, via l’École supérieure des technologies industrielles avancées (Estia), a souvent été à l’initiative. “Dans le cas [Lauak], l’essentiel pour nous, au fond, c’est de maintenir les emplois”, explique Sylvie Durruty, se refusant à commenter le choix des dirigeants.
La situation de Lauak a enfin été évoquée au Conseil communautaire, le 21 septembre dernier, par Alain Iriart (EH Bai) : “Devons-nous rester spectateurs ? Quid des activités nobles, à haute technologie et valeur ajoutée qui sont souvent mobilisatrices de compétences humaines et profitables à l’emploi ? Ne risquent-elles pas d’être transférées ailleurs ?”. L’élu a invité à plus de coopération économique avec le Pays Basque Sud. Comment ne pas rappeler, en effet, que la Communauté autonome basque est une championne internationale de la réindustrialisation et qu’elle a su recapitaliser des groupes aussi puissants que Talgo et CAF.
En attendant plus de souveraineté locale pour ne plus regarder passer les trains…